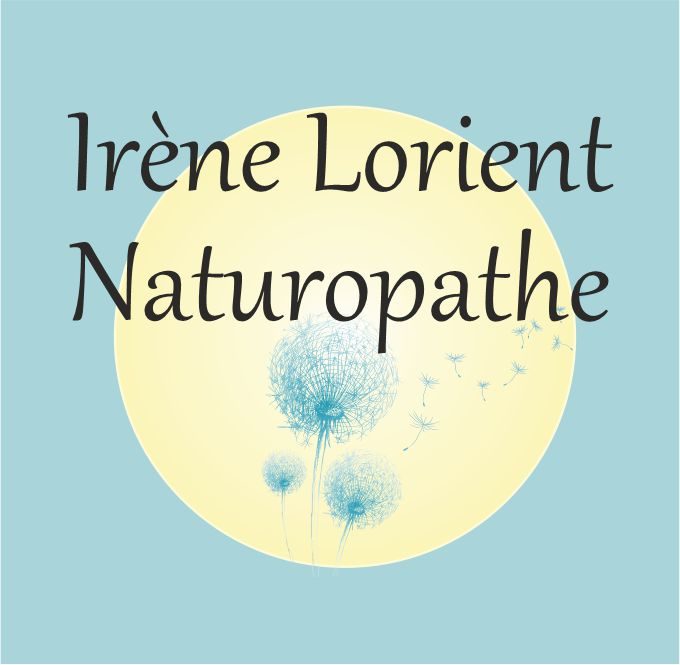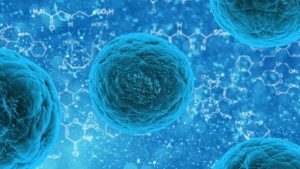http://www.suds-en-ligne.ird.fr/foret/habitants/chasseurs.html
Qu’est-ce qu’un mode de vie chasseur-cueilleur ?
Jusqu’à il y a environ 12 000 ans, la quasi-totalité de l’humanité vivait de chasse et de cueillette, avant l’avènement de la grande transition du néolithique qui a été marquée par l’adoption de l’agriculture. Le mode de vie chasseur-cueilleur est caractérisé par une subsistance dépendant prioritairement — mais pas de façon nécessairement exclusive — des produits naturels dispensés par la nature. Ce mode de subsistance a conduit à l’élaboration de savoirs, savoir-faire et pratiques sur la nature qui sont particulièrement élaborés. Ces savoirs naturalistes locaux sont mobilisés à travers une organisation sociale et politique qui privilégie le collectivisme : entraide, partage et mise en commun des ressources sont des principes récurrents dans ce type de sociétés. Enfin, l’accès aux ressources dispersées en forêt contraint à des déplacements fréquents en petits groupes. On parle de nomadisme ou de migration saisonnière. Le fait de vivre dispersé dans de vastes territoires forestiers faiblement peuplés (normalement moins d’un habitant par kilomètre carré) constituait une réponse adaptative efficace à la diversité élevée des maladies parasitaires et infectieuses. Grâce au caractère transitoire de leurs installations, les chasseurs-cueilleurs étaient peu exposés aux maladies transmissibles, aux parasites aérogènes et d’origine alimentaire et à la pollution fécale. Plus que la rareté des aliments, c’est l’excès de parasites (puces, poux et tiques) dans le campement qui était la principale incitation à se déplacer. La mort d’un membre de la communauté encourageait aussi celle-ci à se disperser en effectifs réduits, afin d’atténuer le risque qu’un facteur létal contamine les autres membres du groupe.
Le volume restreint de biens à transporter et le nombre limité d’enfants vivants rendaient la mobilité plus aisée. Les groupes migraient le long de sentiers territoriaux étendus et linéaires. Les migrations régulières le long de ces pistes réduisaient les risques liés à la recherche de ressources alimentaires, car les chasseurs-cueilleurs possédaient et géraient ces ressources à l’intérieur de leurs territoires, en contrôlant leur répartition spatiale et leur densité.
Aujourd’hui, les peuples chasseurs-cueilleurs résidant dans les forêts tropicales sont estimés à environ 1,3 millions de personnes et ne représentent qu’à peine 0,002 % de la population mondiale. . C’est donc dire si ces peuples ne représentent qu’une fraction infime de l’humanité.
Malgré leur tout petit nombre, ces peuples fédèrent une incroyable diversité culturelle. Les 700 000 chasseurs-cueilleurs amérindiens de la grande Amazone, répartis sur 9 pays différents, représentent 186 ethnies bien distinctes. En forêt du Bassin du Congo, les 150 000 personnes que l’on reconnaît habituellement sous le nom de “Pygmées” représentent en réalité une douzaine d’ethnies séparées distribuées dans 11 pays différents. En Asie, les 450 000 chasseurs-cueilleurs répartis dans 5 pays, représentent près de 870 ethnies différentes. 93 % de cette diversité culturelle se trouve concentrée sur la seule île de Papouasie, véritable mosaïque de peuples à très faible représentation numérique car la grande majorité d’entre eux compte moins de 5 000 personnes. La diversité culturelle concentrée dans cette goutte d’eau d’humanité est 300 fois supérieure à celle qu’héberge un pays comme la France et est équivalente à celle du Cameroun, pays souvent cité comme exemple de nation à haute diversité ethnique.
Numériquement parlant, ces peuples constituent déjà une rareté ; cette rareté se double d’une diversité culturelle exceptionnelle. Ils rejoignent en cela la diversité biologique des forêts tropicales humides, qui est la plus élevée de la planète et qui comprend de nombreuses espèces rares qui sont condamnées à disparaître avant même d’être répertoriées.
Pourquoi si peu de gens font tant parler d’eux ?
On observe à l’égard des derniers chasseurs-cueilleurs forestiers de la planète deux attitudes que tout oppose, et qui sont tout autant néfastes l’une que l’autre.
La première est celle des Occidentaux éprouvant une admiration nostalgique de ces peuples. Cette admiration a quelque chose de malsain car elle est encore largement entretenue par les médias et les reportages naturalistes très en vogue (Ushuaïa Nature, Discovery Channel, etc). Survival International cultive encore le culte des peuples non-contactés par l’Occident (www.uncontactedtribes.org). Ces sociétés qui nous font fantasmer sont perçues comme des vestiges d’un passé révolu où toute l’humanité vivait de chasse-cueillette. Cette inclination à figer ces peuples dans le passé de l’histoire évolutive des sociétés humaines (« ils vivent comme vivaient nos ancêtres ») les érige en fossiles vivants, donc en patrimoine de l’humanité. En leur déniant le fait d’être nos contemporains, l’on s’octroie implicitement le droit de décider de leur sort ou de ce que l’on estime être le plus approprié pour eux, et d’agir comme on le ferait à l’égard d’une peinture rupestre des grottes de Lascaux ou d’une momie remarquablement conservée : s’empresser de les mettre sous cloche pour les préserver des miasmes de notre monde actuel, tout en permettant aux touristes ébaubis de venir les “admirer”.
La seconde attitude est celle des gouvernants des pays dans lesquels vivent ces peuples. Quelle que soit la latitude, les états ont horreur des nomades. Ce sont des personnes qui ont un mode très extensif d’occupation de l’espace, qui s’affranchissent du respect des frontières administratives et qui échappent à tout contrôle. En forêt comme ailleurs, les autorités veulent fixer ces populations et les faire rentrer dans le cadre normatif du développement. Sous le prétexte d’agir pour leur bien-être, les autorités contraignent les derniers nomades à la sédentarisation et au renoncement à un mode de vie jugé archaïque et indécent. En échange de l’obtention de la citoyenneté (qui se résume à l’octroi d’une carte d’identité, d’un droit de vote et d’un droit… à payer l’impôt), les derniers chasseurs-cueilleurs se voient contraints à adopter l’agriculture. Leur fixation et leur contrôle ne servent souvent que de préambule à un pillage institutionnalisé des nombreuses ressources que recèlent leurs territoires, et leur condition de vie n’ont plus rien d’enviable.
Que l’on soit un fervent défenseur de ces peuples ou un redoutable détracteur de leur manière de vivre, notre inclination tend à les spolier de toute autodétermination face à un monde en plein changement qui les condamne à ne plus pouvoir maintenir un mode de vie chasseur-cueilleur perdurable.
Pourquoi persister à dédier des recherches à ces peuples ?
Plusieurs raisons justifient le fait de continuer à mener des recherches en partenariat avec ces derniers peuples nomades chasseurs-cueilleurs :
Nutritionnelle: la diversité incroyable du microbiote de ces peuples a été comparée à la pauvreté de celui des occidentaux et promet de nouvelles découvertes en ce sens.
– Scientifique : la forte dépendance de ces sociétés vis à vis de leur nature en fait un objet d’étude idéal pour analyser la complexité des interactions en présence, notamment dans les environnements à diversités culturelle et biologique élevées que sont les forêts tropicales humides. Ces sociétés vivant en étroite interdépendance avec leur environnement naturel ont acquis des savoirs et savoir-faire indéniables à l’égard d’une biodiversité propre à leur lieu de subsistance. À l’heure où les préoccupations environnementales suscitent une demande sociétale grandissante, les chercheurs en ethnoscience doivent plus que jamais se faire les avocats de ces savoirs en perdition.
– Philosophique : sans vouloir chercher à faire de ces sociétés les nobles sauvages qu’elles ne sont pas, ces sociétés n’en sont pas moins emblématiques de cette réconciliation nécessaire entre notre espèce et l’environnement naturel qu’elle altère de manière irrémédiable et souvent dramatique. Ni bons sauvages, ni destructeurs de l’environnement, les derniers peuples nomades de la planète sont des sociétés naturalistes qui ont en commun la contrainte de devoir rapidement s’adapter à de nouvelles conditions économiques, souvent au prix de leur intégrité culturelle. Ils aspirent aujourd’hui à la citoyenneté et revendiquent un droit légitime à la santé, à l’éducation, à la reconnaissance de leur patrimoine, à l’accès à l’économie de marché, et à la tenure foncière.
– Sensibilisation et action : jusqu’à un passé récent, ces peuples forestiers ne suscitaient guère l’intérêt des autorités du fait de leur faible effectif et de leur relatif enclavement. Mais depuis peu, ces sociétés focalisent l’attention des organisations de développement en raison de nouveaux enjeux économiques ou de conservation pesant sur les milieux naturels qu’elles occupent. En empruntant au jargon de l’écologie de la conservation, on pourrait dire qu’il s’agit de “sociétés indicatrices” propres à toucher le grand public et les décideurs. Malheureusement elles sont, bien souvent manipulées comme porte-drapeaux des organisations indigénistes sur la scène internationale.
– Éthique : ces peuples au devenir incertain risquent de payer plus chèrement que tout autre, les conséquences du changement climatique sur leur environnement, alors que, comble d’ironie, ils sont ceux qui contribuent le moins à l’émission des gaz à effet de serre. Rappelons en effet que le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) identifie l’effet de serre comme le principal mécanisme conduisant au réchauffement climatique et estime comme hautement probable la responsabilité des activités humaines dans ce changement.