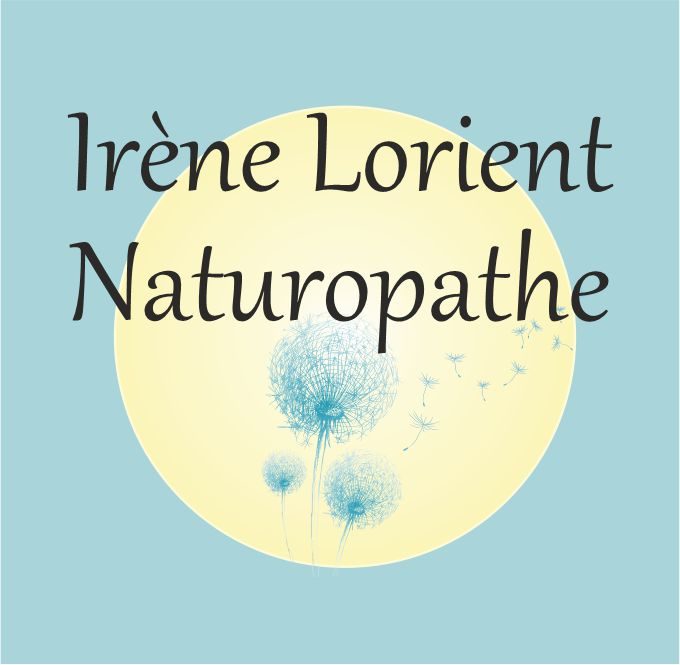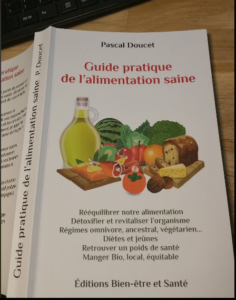Image par LysogSalt de Pixabay
La violence au sein des groupes humains et entre eux n’est pas un phénomène récent. C’est un comportement qui se retrouve tout au long de l’histoire humaine. Mais ces guerres primitives de ces petits groupes ou tribus étaient motivées par des besoins fondamentaux de subsistance et de concurrence territoriales.
Cette violence ne doit pas être confondue avec la violence gratuite, la délinquance, dont la recrudescence est observée surtout depuis les années d’après guerre. Une lente transition et dégradation de cet état de fait se superpose au changement de nos habitudes alimentaires. Notre alimentation se détériore régulièrement. Nous détruisons notre « écologie intérieure », notre microbiote intestinal aussi surement que notre écologie extérieure.
Délinquance alimentaire…
https://www.denisriche.fr/d%C3%A9linquance-alimentaire/
Et si votre gestion du stress, et donc votre violence, pouvait être conditionnée par ce qui se trouve dans votre assiette ?
C’est un des textes dont on souvient longtemps après l’avoir écrit et qui, quand on en évoque l’idée dominante autour de soi, ne manque pas de surprendre ou de désarçonner son interlocuteur. En effet, considérer que notre manière de manger peut conditionner tout simplement notre facilité à franchir les barrières de la légalité, çà a de quoi déranger.
Mais en même temps, si on reconnaît des vertus stimulantes à certaines substances, des aptitudes hypnotiques à certaines plantes, un effet sur la mémoire à certains nutriments, pourquoi nos comportements, qui font appel à des neurones constitués et activés par des constituants de notre ration, ne dépendraient-ils pas aussi des nos choix alimentaires ?
Si en psychiatrie on améliore des maladies ou des symptômes graves en apportant des molécules qui miment (en plus fort) l’effet de molécules naturellement présentes dans notre cerveau- et élaborées à partir de notre ration- alors comment ne pas admettre que selon ce qu’on mange notre cerveau va fonctionner de manière différente ?
La notion de délit suggère qu’on a enfreint une règle de société et qu’une sanction est nécessaire. Celle-ci, dans le contexte du débat moderne qui anime la Justice, place la notion de « responsabilité » au cœur de l’évaluation de la gravité de la faute et de la punition qui vient la réparer. Cet article souligne un point montré du doigt par des juristes et des politiques Britanniques : Comment concevoir cette notion de responsabilité si certains de nos actes sont modifiés par des facteurs dont nous ignorons- à l’instar de la malbouffe ou de la pollution- l’exacte importance ? Cette réflexion fait basculer la thématique nutritionnelle abordée dans ce texte dans le champ de la sociologie. Pour preuve, une dernière anecdote à son sujet ; au moment de faire paraître l’article, une assez longue discussion a eu lieu entre Gilles Goetghebuer et moi-même sur le fait que le thème abordé ne collait pas vraiment à l’actualité ni aux préoccupations des sportifs. Moins de six mois après sa parution, les banlieues s’embrasaient, et il fallut à peine six mois de plus pour assister au dernier coup de tête de Zizou, que d’aucuns continuent, plus de trois ans après, à juger inexplicable…
Nutrition et Violence
A l’heure où la violence, dans et autour des stades, se manifeste de plus en plus, d’aucuns s’interrogent sur les causes de ce fléau et sur la politique de prévention à mettre en œuvre. Pour certains sociologues, ces dérapages parfois à la limite du délit ne sont rien d’autre que l’expression dans le milieu sportif de la tendance globale qu’on retrouve à l’échelle de la société toute entière. Quelques experts britanniques n’hésitent pas à mettre en avant, parmi les différentes explications envisageables, la place de la nutrition. Peut-on penser que, mieux alimenté, Barthez n’aurait pas craché sur un arbitre marocain lors d’un match amical ? A les en croire, ce serait le cas…
Trop beau pour être honnête
Les statistiques anglaises sont formelles. Les actes de délinquance enregistrés ont été multipliés par sept en l’espace de cinquante ans. La faute à l’abandon de la morale pour les uns, à la télévision pour les autres, au relâchement des mœurs et à la démission parentale pour les troisièmes, à la pauvreté, au déracinement ou au chômage pour les derniers. Chacun y va de son explication et de son a priori, fortement influencé par son éducation et son origine sociale. Or, alors que les politologues, les économistes ou les psychologues dissertent sur les causes de cette évolution inquiétante, le professeur Rutter (35) avance à contre-courant, défendant une hypothèse radicalement différente : « Une augmentation aussi importante ne peut s’expliquer autrement que par un facteur environnemental. Elle n’est pas dûe à une cause sociologique. Cela veut dire que si la société s’est montrée efficace pour provoquer un tel accroissement de la criminalité, il existe un réel potentiel pour qu’une intervention bien ciblée puisse tout aussi rapidement inverser la tendance ». Pour lui, l’augmentation de l’incidence est trop rapide, trop soudaine, pour résulter de phénomènes liés à la génétique ou à la sociologie. Elle ne dépend pas non plus d’une meilleure qualité du recueil des infractions de tout genre, comme on peut le constater, par exemple, avec les statistiques du cancer du sein. Alors quoi ? Selon les chercheurs de l’Université de Aylesbury, ce brutal accroissement de la criminalité, serait lié à une transformation du mode de fonctionnement et de l’environnement de notre cerveau, et plus particulièrement de la manière dont on l’alimente. Pour Rutter et ses collègues, l’une des clefs de la prévention résiderait dans une meilleure politique nutritionnelle. Les modifications spectaculaires de la qualité de notre ration, survenue depuis un demi-siècle, ne contredisent pas cette vision des choses. Reprenons-les au début…
L’idée d’une possible relation entre l’alimentation et la délinquance remonte à la Seconde Guerre Mondiale. Les faits sont restés relativement méconnus, mais cette période terrible de l’histoire mondiale s’est caractérisée, au Royaume Uni, par une inflation de la criminalité. Evidemment, en regard des bombardements aériens, des conflits, de l’impact économique, ces actes antisociaux ne pesaient pas bien lourd. Pourtant, c’est dès 1942 que le professeur Hugh Sinclair a réussi à persuader le Gouvernement britannique de complémenter l’alimentation de toutes les femmes enceintes et des enfants avec de l’huile de foie de morue et du jus d’orange (19) .Il avait en effet constaté de très faibles taux sanguins de nombreuses vitamines et d’acides gras essentiels. Il émit l’hypothèse que ces perturbations pouvaient conduire à beaucoup de pathologies et à des comportementaux antisociaux. De son point de vue, pathologie et trouble à l’ordre social n’étaient pas si éloignés de cela. La notion de « responsabilité » lui semblant atténuée du fait que des carences pouvaient, selon lui, troubler le bon déroulement des fonctions mentales. Cette façon de concevoir le délit possède aujourd’hui encore ses partisans. Dans un document confidentiel signé en octobre 2003 de la main de Lord Coulsfield, et destiné au Ministère de la Justice Britannique, un problème de fond est longuement soulevé ; c’est celui de la notion de « culpabilité » (13). On y lit que « la forme classique de la justice considère que l’homme possèderait son libre arbitre, et pourrait choisir de manière délibérée de commettre un délit. Dans ce cas, la culpabilité peut être clairement établie. Le délit sera alors apprécié relativement à un ensemble d’éléments juridiques fixant des limites acceptables aux actes et la gravité des fautes commises. Les lois répondent ainsi au souci d’encourager à se plier aux normes de la communauté en termes de comportement. Ces lois partent du principe que le fait de les enfreindre ou non relève du libre arbitre. Mais est-ce vraiment le cas s’il y a des facteurs qui affectent le comportement sans même que le délinquant en ait conscience ? » Cette philosophie plutôt libérale en matière de justice ne repose pas sur rien. En effet, de récentes études ont apporté du crédit à cette école de pensée, et compte tenu de la parfaite similitude entre l’évolution du nombre d’actes délictueux, des cas de pathologie mentale et des actes anti-sportifs, elles méritent d’être portées à la connaissance du monde athlétique et des instances dirigeantes.
Un cerveau « maigre » est dangereux
La frontière entre carence (génératrice de troubles fonctionnels), pathologie et acte délictueux est parfois très étroite. Ceci apparaît de manière particulièrement nette avec le problème des acides gras « oméga 3 » à longue chaîne. De nombreuses études ont montré que les acides gras polyinsaturés jouent un rôle essentiel dans la physiologie du système nerveux central. Les situations de déficit, notamment en « oméga 3 » sont très fréquentes. Que se passe-t-il alors sur le plan des fonctions cérébrales ? Le tableau est apparemment inquiétant. En effet, certains troubles neuropsychiatriques sont étroitement corrélés à des déficits biologiques chroniques en « oméga 3 » . Ils se sont vraisemblablement constitués très tôt, dès l’âge fœtal, et ont été entretenus ensuite par des choix alimentaires inappropriés. Ce processus est apparemment retrouvé dans des tableaux aussi variés que la schizophrénie, la dépression l’autisme ou l’hyperactivité (10, 21, 25, 26, 42). Par exemple, l’existence d’une déficience en acides gras essentiels dans les « Troubles Hyperkinétiques Avec Déficit de l’Attention » (« THADA »), a été décrite pour la première fois au Royaume-Uni par Colquoun et Bunday en 1981 (11).Cette approche est souvent associée à d’autres stratégies nutritionnelles, dans la mesure où ces perturbations des fonctions cérébrales ne résultent pas uniquement d’un déficit en acides gras (32), même si, compte tenu de leur importance pondérale au niveau du cerveau (60% en poids sec de la matière grise), ces déficiences ont évidemment des conséquences très parlantes. Or, ce trouble, comme la schizophrénie, est certainement plus souvent susceptible de conduire les patients qui en souffrent à commettre des actes délictueux. De récents travaux faisant appel à la mesure des taux sanguins de certains acides gras polyinsaturés, en particulier l’acide arachidonique (« oméga 6 ») l’EPA et le DHA ( encore appelé « acide cervonique ») ont d’ailleurs établis que ceux-ci sont réduits chez les enfants hyperactifs relativement à des enfants témoins (8, 39). Inversement, diverses études durant lesquelles ces graisses ont été fournies à des doses supérieures, et comparées à un placebo, ont conduit à une dissipation de la plupart des manifestations de THADA (1, 2, 33, 36). Comme par hasard on retrouve chez les jeunes délinquants, sur le plan biologique, ces déficits très marqués en acides gras essentiels (12, 23, 43).
Les causes de ces déficits chroniques sont aujourd’hui bien connues. Il s’agit d’abord de l’appauvrissement des denrées les plus courantes. Ainsi, le Pr Gesch rapporte-t-il dans un de ses articles que, comparativement à l’édition parue en 1936, les données nutritionnelles des fruits et légumes reportées dans la table de référence anglaise (Mc Cance et Widdowson), celles figurant dans l’édition 1991 ont beaucoup diminué (28). De plus les choix alimentaires pratiqués, et les bouleversements rencontrés depuis le début des années 50, ne permettent plus de rencontrer les besoins qui correspondent au fonctionnement optimal de notre cerveau et à notre capital génétique, figé depuis 40.000 ans (15). Ceci concernerait d’ailleurs non seulement les « oméga 3 », mais aussi d’importantes vitamines, souvent « limitantes », et très impliquées dans les fonctions cérébrales, telles que la B9 et la B6, ou la vitamine E qui participent notamment aux synthèses des neurotransmetteurs (5, 9, 40).
A l’appui de cette hypothèse des apports « limite », Gesch souligne que les courbes de délinquance en fonction de l’âge sont superposables quels que soient les époques et les lieux considérés. Ils culminent notamment chez les hommes à la fin de l’adolescence. Il tente de rapprocher ce constat du fait qu’à ce moment précis de leur vie les mâles connaissent une accélération spectaculaire de leur croissance, à l’inverse des représentantes du beau sexe chez lesquelles elle demeure plus linéaire. Il pense qu’à ce stade de la vie le cerveau se trouve en concurrence avec d’autres organes et que cette compétition, dans le contexte de cet environnement nutritionnel défavorable, ne peut plus tourner à son avantage. Les prisons américaines regorgent majoritairement d’adolescents ou de jeunes adultes. Il est certain que l’évolution de la délinquance en ce début de siècle ne coïncide pas par hasard avec l’émergence de la malbouffe et de la restauration rapide. Pas plus que la corrélation entre ces problèmes de société et l’augmentation exponentielle des problèmes d’allergie n’est fortuite…
Le dopage des détenus
Lord Coulsfield et ses amis juristes sont-ils de doux rêveurs décalés des réalités de la vie ? Détrompez-vous, soucieux de mettre leur théorie à l’épreuve du terrain ils ont décidé, comme les deux financiers du film « Un fauteuil pour deux », de mettre en place une expérience. L’objectif de ce travail mené par le Pr Gesch consistait à regarder si les déficits nutritionnels pouvaient contribuer à l’apparition de comportements anti-sociaux et si, inversement, la correction de ces déficits pouvait ramener dans le droit chemin quelques brebis égarées (18). L’étude entreprise s’est déroulée selon une méthodologie en double aveugle. 231 détenus furent recrutés, et ni eux, ni le personnel de la prison, ni même les chercheurs avant la levée de l’aveugle ne savaient qui recevait un placebo, et qui bénéficiait de l’apport d’un complément de vitamines, minéraux et acides gras essentiels à dose nutritionnelle. Le nombre de délits commis durant l’incarcération fut rigoureusement enregistré. Il est apparu que ceux qui avaient reçu véritablement les micronutriments, commettaient un nombre d’actes répréhensibles significativement moins élevé. La différence, relativement au groupe « placebo », se chiffrait à 26,3%. Et si le protocole avait été poursuivi un minimum de 2 semaines, l’écart était alors encore plus important, approchant 37%, notamment en ce qui concerne les faits les plus graves tels que des actes de violence. Cet écart statistique correspond à une différence supérieure à deux écarts-type. Ceci écarte toute éventualité que ce qu’on a observé fût seulement l’effet du hasard. Comme le soulignent les auteurs de ce travail, il démontre qu’un facteur jusque là jamais pris en compte exerçait un effet avéré sur la délinquance. Ce constat est à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant du fait qu’il montre une possibilité d’intervenir de manière préventive par des mesures très simples. Inquiétant parce que l’analyse détaillée du niveau des apports nutritionnels des prisonniers confirme l’existence d’un certain nombre de déficits (notamment en sélénium, avec 60% de déficits chez les prisonniers étudiés en 1997, et en acides gras (17) (*). Certes, mais le niveau moyen d’apport de certains nutriments est supérieur à celui enregistré au sein de certains groupes de la population non carcérale. Comme le soulignait Lourd Coulsfield en 2003, près de deux millions d’enfants vivent, au Royaume-Uni, sous le seuil de pauvreté. Qui a dit que la population carcérale se recrutait surtout dans les rangs des classes défavorisées ?
A l’appui de cette conclusion, citons les résultats d’un travail conduit auprès d’enfants mauriciens. Il a consisté à enrichir leur environnement nutritionnel et social de leur 3e à leur 5e anniversaire, puis à relever, lors de leur entrée à l’âge adulte, combien d’entre eux avaient commis des actes de délinquance (31). Ce travail a montré que, comparativement à un groupe « témoin », les bénéficiaires de ce plan de prévention se retrouvaient beaucoup moins souvent impliqués dans des affaires de justice. Mais ce n’est pas tout ; sur cette question, là encore, il est possible d’établit un parallèle entre les détenus et les personnes atteintes de pathologies mentales ou psychiques. En effet, en marge des affaires de justice, ce travail a aussi montré que les enfants pris en charge entre 3 et 5 ans développaient beaucoup moins de pathologies mentales, souffraient mois de dépression, consommaient moins de drogue et enfin étaient moins souvent affectés de dyslexie. Ces divers travaux ouvrent évidemment tout un registre passionnant de possibles interventions pédagogiques et préventives. Et tant pis si Fabien Barthez préfère aller au Mc Do.
(*) : l’importance des déficits en sélénium sur les troubles fonctionnels cérébraux ou psychiques, sur les retards de développement moteur ou sur les problèmes de mémoire et de facultés mentales chez les seniors n’est plus à démontrer (4). Ceci peut expliquer la corrélation inverse observée entre consommation de fruits de mer (source de sélénium et de zinc) et la fréquence des homicides commis (24), quand bien même la propension à consommer crustacés et mollusques serait en partie déterminée par des données socio-économiques susceptibles de confondre les conclusions de ce travail. Par ailleurs, d’autres travaux associent carence en lithium et risque accru d’accomplissement de crimes, de suicide ou d’arrestation en rapport avec des problèmes de drogue (38). Souvenons-nous que, à des doses plus importantes, le lithium est utilisé dans le cadre de la prise en charge des dépressions… Toujours cette étroite passerelle entre maladie et délinquance, et le débat délicat qu’elle suscite autour de la notion de « responsabilité ».
Plus de tolérance et moins de métaux
L’influence de l’alimentation sur le risque de délinquance ne se limite pas au seul aspect des déficits. Deux autres voies de réflexion se sont ouvertes ces dernières années. La première concerne la pollution par les métaux lourds et notamment, en ce qui concerne le Royaume Uni, celle liée à la présence de plomb dans les carburants automobiles (6, 7, 22, 29). On leur attribue un impact direct sur les neurones, et en particulier sur les membranes neuronales, ce qui fausse notablement le déroulement de certains processus cérébraux. Ils pourraient ainsi contribuer à des troubles mentaux ou à des problèmes de délinquance. D’ailleurs, la courbe retraçant l’évolution de la teneur en plomb de l’air des 50 dernières années se superpose tout à fait à celle qui traduit l’augmentation du nombre de délits commis sur le même période (29). Ajoutons à ceci qu’un des moyens mis en œuvre par notre organisme pour nous détoxiquer de la présence des métaux lourds est un système enzymatique faisant appel au sélénium (4). On a vu la fréquente survenue de déficits chez les populations britanniques. Il en va de même en France, d’autant que c’est la richesse des sols et cet élément qui détermine principalement la teneur de nos aliments en sélénium. Notre territoire est plutôt fourni en sols séléniprives. Par conséquent, l’effet conjoint du toxique s’ajoute donc à celui du déficit de l’antidote.
D’autres auteurs se sont posés la question d’un possible intérêt de régimes d’éviction, partant du principe que, comme dans le cas des allergies, des réponses aberrantes à certains aliments, sur fond de perméabilité intestinale, pouvaient participer à des problèmes comportementaux ou antisociaux. Dans le Shipley Project (3), neuf adolescents qui avaient commis de multiples délits ont vu leur comportement changer radicalement après une modification de leur régime alimentaire, éliminant notamment les aliments à l’origine de manifestations d’intolérance. Deux ans après, deux des enfants, qui avaient repris leurs habitudes antérieures, étaient retombés dans la délinquance. Cet intérêt apparent des régimes d’éviction se retrouve, de manière similaire, dans le cadre de la prise en charge de l’autisme. A nouveau la passerelle entre troubles comportementaux et risque de délinquance se retrouve. L’équipe du Pr Reichelt a ainsi pu établir que l’élimination du gluten et des protéines laitières s’accompagnait d’une rémission assez sensible des troubles autistiques (44).
Dans une étude pilote réalisée aux Pays Bas (30), les auteurs ont montré que le remplacement de l’alimentation habituelle par un régime d’élimination à base de quelques aliments simples peu allergisants (dinde, laitue, riz, poire…) améliorait rapidement le comportement d’une majorité d’enfants hyperactifs participant au test. Plusieurs autres spécialistes ont souligné l’importance des relations entre alimentation, tolérance orale, et comportement (36, 41). Cette réflexion se nourrit de données somme toute anciennes, inspirées des travaux conduits dans le cadre de la prise en charge des enfants autistiques.
En conclusion, les troubles de comportements résultent des influences conjointes de la pression sociale, de traits de caractère plus ou moins innés (plus ou moins dans le sens où ils sont modulés par les neuromédiateurs et le statut en acides gras, eux-mêmes dépendant en partie de notre assiette) et enfin de notre alimentation.
Apparemment, l’optimisation de la nutrition, dans une approche individualisée, s’avère extrêmement efficace pour limiter les problèmes de délinquance, de dépendance ou de troubles du comportement alimentaire. Rien n’empêche d’imaginer qu’on peut aller dans d’autres directions, par exemple celle du « mental » des champions. Quand on observe comment ils mangent, ce n’est pas une… vue de l’esprit. Ce serait en tout cas un axe de réflexion très judicieux de la part de tous ceux qui veulent faire œuvre de prévention et se positionner comme des acteurs du monde social à travers le sport. Et çà coûterait sûrement moins cher que d’investir à fond perdu avec nos deniers pour ne pas obtenir l’attribution des Jeux dans la Ville lumière !
L’autisme démarre dans l’intestin
Il est aujourd’hui reconnu par les spécialistes de la question que l’autisme démarre avec un problème d’hyperperméabilité intestinale. Lorsqu’elle survient, par exemple dans le cadre d’efforts intenses ou prolongés répétés, ou en cas de perturbation chronique de l’écosystème intestinal (34), elle va concerner de nombreux aliments, y compris ceux qui sont moins « immunogènes » que le lait de vache. Cette perméabilité accrue favoriserait non seulement le passage de protéines (qui par leur poids moléculaire élevé sont reconnues par le système immunitaire et traitées comme des « antigènes ») ; elle favorise également le passage de petits fragments de ces protéines, partiellement digérés, et ayant gagné la circulation. Ce sont des peptides. Mais ceux-ci sont bien particuliers : certains d’entre eux présentent de fortes analogies de structure avec des entités normalement présentes dans notre organisme. Celles-ci s’apparentent à la famille des « opiacés endogènes » ou « endomorphines ». La présence dans le sang de tels peptides issus de la dégradation complète d’aliments courants pose problème. En effet, la « caséomorphine », issue de la caséine du lait de vache ou la «glutomorphine » tirée du gluten (protéine de blé et dérivés), sont évoquées dans le cadre de certains troubles psychiatriques (14, 16, 20, 44). L’hypothèse de leur contribution à des troubles tels que la schizophrénie fut émise dès 1966 par Dohan (14). Leur présence à des taux anormalement élevés est certifiée par le dosage urinaire de ces molécules. Cette démarche, aujourd’hui validée par la communauté scientifique, mais peu pratiquée de manière routinière en raison de son coût, a permis de confirmer l’intérêt des régimes d’éviction dans le cadre de certaines pathologies où des aliments participaient. C’est ainsi que Reichelt et son équipe avancent des résultats probants dans le cadre de la prise en charge de l’autisme (44). Dohan suggérait, il y a déjà 40 ans, que : « le problème majeur de la schizophrénie consiste en une perturbation biologique ou une anomalie génétique au niveau intestinal ».
Ce point de vue reste valable aujourd’hui. Cette anomalie qu’il évoque pourrait concerner des enzymes ou des protéines récepteurs.
Bibliographie :
(1) : AMAN MG, MITCHELL EA & Coll (1987) : J.Abnorm.Child Psychol., 15 : 75-90.
(2) : ARNOLD LE, KLEYKAMP D & Coll (1989) : Biol.Psych., 25 : 222-8.
(3) : BENETT P & Coll (1998) : J.Nutr.Env.Med., 8 : 77-83.
(4) : BENTON D, COOK R (1991) : Biol.Psych., 29 (11) : 1092-8.
(5) : BOTTIGLIERI T, LAUNDY M & Coll (2001) : J.Neurol.Neurosurg.Psychiatry, 70 (3) : 419.
(6) : BRYCE-SMITH D, WALDRON HA (1974) : Ecologist, 4 (10) : 367-77.
(7) : BRYCE-SMITH D (1986) : Int.J.Biosocial Res., 8 (2) : 115-50.
(8) : BURGESS JR, STEVENS L & Coll (2000) : Am.J.Clin.Nutr., 71 : 327-30.
(9) : CASTANO A, HERRERA AJ & Coll (1993) : Neurosci., 53 (1) : 179-85.
(10): CHRISTENSEN JH, CHRISTENSEN MS & Coll (1999) Am.J.Clin.Nutr., 70 : 331-7.
(11): COLQUOUN I, BUNDAY S (1981) : Med.Hyp., 7 : 673-9.
(12): CORRIGAN FM, GRAY R & Coll (1994) : J.Forensic Psych., 5 (1) : 83-92.
(13): COUSFIELD L (2003) : Natural Justice, Oxford Univ.
(14): DOHAN FC (1979) : Lancet, 1 : 1031.
(15): EATON SB, SINCLAIR A & Coll (1998) : World Review of Nutrition and Dietetics, 83 : 12-23.
(16): EGGER J, CARTER CM & Coll (1983) : Lancet, 2 : 865-9.
(17): EVES A, GESCH B (20003) : J.Hum.Nutr.Diet., 16 : 167-79.
(18): GESCH CB, HAMMOND SM & Coll (2002) : Br.J.Psych., 181: 22-8.
(19): GESCH CB (1990) : “The South Cumbria (England) Alternative Sentencing Option (SCASO) Project”. Int. J. Biosocial.Med.Res., 12 (1) : 41-68.
(20): GRANT EC (1979) : Lancet, 2 : 966-69.
(21): HAAG M (2003) : Can.J.Psych., 48 (3) : 195-203.
(22): HALL RW (1989) : Int.J.Biosco.Med.Res., 11 (2) : 144-52.
(23): HAMAZAKI T, SAWAZAKI S & Coll (1996) : J.Clin.Invest., 97 : 1129-33.
(24): HIBBELN JR (2000) : World Rev.Nutr.Diet., 85 : 41-5.
(25): HORROBIN DF (1998) : Schizophren.Res., 30 : 193-208.
(26): MAMALAKIS G, TORNARITIS M & Coll (20002) : Prostag.Leuk.Essent. Fatty Acids, 67 : 311-8.
(27): MASTERS RD, COPLAN MJ & Coll (2000) : Neurotoxicology, 21 (6) : 1091-1100.
(28): MAYER AM (1997) : Brit.Foood J., 99 (6) : 207-11.
(29): NEEDLEMAN HL, RIESS JA & Coll (1996) : JAMA, 275 (5) : 363-9.
(30): PELSSER LM, BUITELAAR JK (2002) : Ned.Tijdschr Geneeskkd, 146 (52) : 2543-7.
(31): RAINE A, MELLINGEN K & Coll (2003) : Am.J.Psych., 160 : 1627-35.
(32): RAPIN I, KATZMANN R (1998) : Ann.Neurol., 43 : 7-14.
(33) : RICHARDSON AJ, PURI BK (2000) : Prostag.Leukot.Essen.Fatty Acids, 63 (1-2) : 79-87.
(34) : RICHE D ( 2004) : NAFAS, 2 (3) : 17-29.
(35) : RUTTER M, GILLER H & Coll (1998) : Prevention and Intervention I. In : Antisocial behaviour by young people. Blackwelll Ed. : 309.
(36) : SCHNOLL R, BURSHTEYN D & Coll (2003) : Appl.Psychobiol. Biofeedback, 28 (1) : 63-75.
(37) : SCHOENTHALER SJ, BIER ID & Coll (2000) : J.Altern.Complement Med., 6 (1) : 19-29.
(38) : SCHRAUZER GN, SHRESTHA KP (1990) : Biol.Trace Elem. Res., 25 : 105-13.
(39) : STEVENS LJ, ZENTALL SS & Coll (1995) : Am.J.Clin.Nutr., 62 (4) : 761-8.
(40) : STONEY CM, ENGEBRETSON TO (2000) : Life Sci., 66 (23) : 2267-75.
(41) : STORY M, NEUMARK-SZTAINER D (1998) : Adolesc.Med., 9 (2) : 283-98.
(42) : TANSKANEN A, HIBBELN JR & Coll (2001) : Arch.Gen.Psychiatry, 58 : 512-3.
(43) : VIRKKUNEN M, GOLDMAN D & Coll (1995) : J.Psych.Neurosci., 20 : 271-5.
(44) : VOJDANI A, O’BRIEN T & Colll (2004) : Nutr.Neurosci., 7 (3) : 151-61.
https://www.denisriche.fr/d%C3%A9linquance-alimentaire/
Un autre article sur le même sujet:
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/culture-societe/certains-aliments-rendent-ils-violent-6574.php
Depuis les années 1970, les relations entre le sucre – l’alimentation en général – et les comportements agressifs ont donné lieu à de nombreuses recherches épidémiologiques et expérimentales. Certains étudient les relations entre l’alimentation, l’humeur et la violence. D’autres s’intéressent plus spécifiquement au rôle du sucre dans les conduites agressives. Enfin, les conséquences de l’alcool sur les conduites violentes sont aujourd’hui bien documentées.
Si ces diverses recherches, que nous allons examiner ici, sont fiables, les résultats (hormis ceux obtenus sur l’alcool) ne sont pas toujours faciles à interpréter. En effet, sauf quand il s’agit de recherches expérimentales, si l’on observe des relations reproductibles entre certains aliments et certains comportements, on n’est en général pas encore capable de dire s’il s’agit de simples coïncidences ne révélant qu’un style de vie particulier, ou s’il existe des relations de cause à effet. Ces recherches sont intéressantes, car elles posent la question des liens entre alimentation et violence, mais nous devons rester prudents quant à leur interprétation.
Commençons par évoquer les liens entre alimentation et humeur. De nombreuses données révèlent qu’en cas d’humeur dépressive, on a tendance à consommer des aliments « consolateurs » (sucre, chocolat, alcool, etc.). Dans une étude réalisée par Tasmine Akbaraly, du Département d’épidémiologie et de santé publique du Collège universitaire de Londres, près de 3 500 personnes âgées de 35 à 55 ans ont été suivies pendant dix ans.
Deux types d’aliments ont été étudiés au moyen d’un questionnaire détaillé visant à suivre les habitudes de consommation de ces personnes : le type a, riche en légumes, fruits et poisson, et le type b, qui comprenait une importante proportion de produits frits et transformés, de produits laitiers riches en graisse et de desserts sucrés. Au bout de cinq ans, tous les participants ont rempli un autre questionnaire évaluant l’humeur et une éventuelle dépression. Les résultats ont montré qu’une alimentation riche en mauvaises graisse et en sucre (de type b) augmentait de 58 pour cent les symptômes dépressifs par rapport à une alimentation intermédiaire. Au contraire, les personnes ayant une alimentation riche en fruits, légumes et poisson (de type a) avaient moins de symptômes dépressifs que la moyenne (26 pour cent). Ainsi, l’alimentation joue un rôle dans certaines formes de dépression.
Les aliments qui réduisent les tendances dépressives
Selon les auteurs de cette recherche, plusieurs mécanismes expliqueraient la relation entre alimentation et dépression. Tout d’abord, les antioxydants, abondants dans les fruits et légumes, protégeraient contre la dépression. Ce serait aussi le cas de l’alimentation de type a en raison de la présence de folates dans les légumes verts (brocolis, choux, épinards, asperges, avocats)